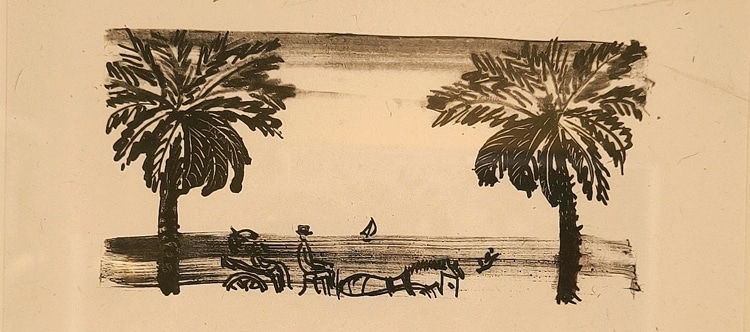
Racines
La racine primaire est pivotante mais, dès le développement de nombreuses racines étalées, elle disparaît, et ne sera jamais renouvelée. Le système racinaire est fasciculé, en faisceaux particulièrement horizontaux, une des caractéristiques des monocotylédones, ceux des Phoenix peuvent atteindre jusqu’à 17 à 25 m de long pour une profondeur de 6 à 7 m. Les racines ne produisent pas de croissances secondaires et gardent leur diamètre ; elles se ramifient rarement, mais en revanche elles se renouvellent très efficacement, il a été remarqué que les racines se régénèrent à d’autres endroits que ceux occupés autrefois par les anciennes. Elles sont fibreuses et charnues, parfois épineuses. Les racines peuvent avoir des relations symbiotiques avec des champignons.
La propagation de nombreuses racines à l’horizontal leur confère une extraordinaire résistance aux vents, aux cyclones, aux typhons.
On distingue différents types de racines :
∙ Les nutritionnelles aux nombreuses radicelles, en sous-sol de 20 cm à 1 m (voire plus), à l’horizontal ou en oblique.
∙ Les absorbantes en sous-sol de 1 à 2 m.
∙ Si nécessaire, selon l’espèce, des absorbantes en faisceaux pivotants peuvent se développer jusqu’à 17 m de profondeur.
∙ Les respiratoires entourent la base du stipe en sous-sol jusqu’à 25 à 50 cm de profondeur, mais certains palmiers développent aussi des racines adventives aériennes formant parfois un manchon racinaire jusqu’à 50 cm de la base du stipe, ainsi elles assurent aussi une meilleure stabilité. Chez certains palmiers, les racines aériennes prennent naissance jusqu’à 2 m au-dessus du sol formant des échasses, cela leur permet de survivre dans un milieu inondable hostile ; elles portent des pneumatodes, des sortes d’ouvertures, ou des zones de pneumatodes, permettant les échanges gazeux, quelques exemples : le palmier marcheur, Socratea exorrhiza – l’espèce monotypique des Seychelles, Verschaffeltia splendida – le palmier de Nouvelle-Calédonie, Cyphophoenix fulcita – le palmier-pinot d’Amérique du Sud, Euterpe oleracea aux échasses rouges…
Les racines horizontales des palmiers marécageux peuvent aussi développer au-dessus de la surface du sol et de l’eau des petits pneumatophores, des excroissances qui assurent la respiration, c’est le cas du palmier-bâche d’Amazonie, Mauritia flexuosa ou encore de l’açai, Euterpe oleracea… Les caractéristiques des pneumatophores sont des critères de classification.


֍ ֍ ֍
Stipes
Les palmiers développent un stipe plutôt qu’un tronc (voir l’article sur le genre Palmier), tout comme les bananiers, les cycas, les fougères arborescentes, les yuccas, les dragonniers…
Phyllophore
Les palmiers sont donc des ‘herbes’ géantes qui se développent à partir d’un bulbe basal plus ou moins enfoncé dans le sol dont le bourgeon terminal, le cœur de palmier appelé autrefois palmite, est blanc, spongieux et mou ; il est constitué d’une sorte de tissu cellulaire indifférencié, un méristème uniquement terminal composé de fibres et de faisceaux libéro-ligneux (liber : conducteur de sève, lignine : bois) qui se renouvellent successivement et d’une moelle de cellules végétales. Son extrémité appelée phyllophore (porteur de feuilles) est spécialisée dans la croissance en longueur, dans la formation de feuilles soutenues par leurs pétioles et d’entre-nœuds, et dans les apports nécessaires à la plante ; le rôle du cœur évolue en vieillissant se transformant dans sa partie basse en organe de soutien suffisamment souple pour faire face aux cyclones.
Le phyllophore, le cœur, est donc la partie essentielle des palmiers, ce qui le rend particulièrement vulnérable, c’est pourquoi les palmiers sont souvent très épineux par mesure de protection ; on retrouve cette caractéristique épineuse de défense chez de nombreuses espèces à stipe, et particulièrement chez les familles des cycadacées et des zamiacées avec leurs féroces épines et leurs folioles coriaces.
Le bulbe basal croît en sous-sol jusqu’à atteindre un certain diamètre définitif correspondant à son espèce. Une fois le diamètre acquis, le phyllophore commence alors à développer des feuilles dont les bases foliaires formeront le stipe ; tout comme les agaves, si le phyllophore est accidenté la plante meurt, néanmoins certaines espèces développent des bourgeons axillaires, au cas où. Le stipe du palmier ne change donc pas de diamètre avec le temps, néanmoins, de nombreux palmiers ont une base plus élargie provenant souvent d’une formation importante de racines adventives ; parfois on constate des variations de diamètre dues aux conditions nutritives ou climatiques : sécheresse, humidité, qui influent sur l’épaississement des cellules.
Chez les palmiers de belles tailles, le phyllophore en ogive donne une forme particulière au sommet du stipe ; quelques exemples : le stipe du palmier de République dominicaine, Pseudophoenix ekmanii prend une forme de jarre élargie vers le sommet – le ‘palmiste marron’ endémique de Rodrigues, Hyophorbe verschaffeltii est en forme de bouteille, comme le palmier bonbonne de l’île Ronde, Hyophorbe lagenicaulis – la forme bouteille du sommet à l’âge adulte du cocotier du Chili, Jubaea chilensis… Cette croissance serait produite par l’augmentation du nombre de canaux de sève à la base du bourgeon terminal, d’ailleurs la récolte de sève est souvent réalisée sur une zone rectangulaire dans cette zone renflée du stipe. Parfois, une dilatation des cellules afin de stocker de l’eau se produit au centre du stipe.


L’absence de croissances secondaires ne permet pas de ramifications comme chez les arbres, mais comme toujours il y a des exceptions : les feuilles des Chamaedorea peuvent porter des bourgeons axillaires prêts à se développer – Nannorrhops richieana produit des ramifications dichotomiques afin de renouveler sa couronne de feuilles monocarpiques ; le palmier sacré d’Égypte, le palmier doum de la vallée du Nil, Hyphaene thebaica développe aussi des ramifications dichotomiques ; on parle de dichotomie lorsque l’axe d’un végétal (inflorescence, feuille, rameau) bifurque en ramifications successives d’importance souvent égale – le palmier d’eau de mangroves, Nypa fruticans développe un stipe souterrain ramifié et, en surface, de longues feuilles jusqu’à 9 à 12 m…
Certaines espèces peuvent développer des rejets (réitérations à partir de la souche), des gourmands (sur le stipe), des drageons (en sous-sol) ; les nouvelles plantes ainsi produites sont donc des clones.
Tailles
L’allure du stipe peut être très rectiligne (Washingtonia filifera), ou moins (Washingtonia robusta), ou particulièrement incliné, c’est le cas du Phoenix reclinata.
Les tailles sont très variées, de quelques cm pour le paraguayen Syagrus liliputiana, aux formes arborescentes parfois très élevées de 20 à 25 m pour les genres Washingtonia, Jubaea, Phoenix, Roystonea, et jusqu’à 60/70 m pour le palmier cire, Ceroxylon quindiuense.
Le plus gros stipe avec un diamètre de 1 à 2 m est celui du cocotier du Chili, Jubaea chilensis, et de 2 m et plus pour le palmier talipot des régions de l’Inde, Corypha umbraculifera.
Architectures
Généralement dans un même genre on peut trouver des espèces dont le stipe peut être solitaire (monocaule), ou à plusieurs en touffe (cespiteux), ou acaule (stipe souterrain ou semi-souterrain), ou former de longues lianes grimpantes ; cela peut dépendre aussi des conditions de culture, ou de traumatismes vécus, forçant à la réitération (développement de nouvel individu), ce qui ne rend pas les identifications aisées !
– Monocaule – stipe solitaire
Les palmiers monocaules développent les plus grandes feuilles du monde végétal, mais moins nombreuses que celles d’un arbre. Ils obéissent au ‘Modèle de Corner’ ou au ‘Modèle de Holttum’ (voir à Fleurs des palmiers).
Quelques exemples : Washingtonia (très rarement cespiteux), Brahea (ou cespiteux, souterrain, rampant), Livistona (sauf une espèce), certains Phoenix (25 % des espèces), Butia (ou cespiteux), Sabal (parfois stipe souterrain), Ceroxylon, Jubaea, Cocos, Caryota (excepté mitis), Trachycarpus, Syagrus romanzoffiana…


– Cespiteux
Les palmiers cespiteux poussent en touffe, ils obéissent au ‘Modèle de Tomlison’ en développant des ramifications basales associées à la souche commune, ou des drageons issus de racines rhizomateuses (charnues) ; le rhizome est une tige souterraine qui emmagasine des réserves de croissance permettant ainsi une multiplication végétative, c’est le cas des Sabal nains ou de certains Raphia. Certains rares palmiers, tel Trithrinax campestris, se développe tout d’abord en rampant, permettant ainsi à certains bourgeons foliaires de rentrer en contact avec le sol et de donner ainsi naissance à de nouveaux stipes.
Les palmiers cespiteux peuvent être acaules (sans stipe), ou développer des stipes, ou être grimpants. Les espèces cespiteuses à stipe élevé peuvent être aussi monocaules selon les conditions.
Quelques exemples : Chamaerops humilis (généralement acaule à l’état sauvage), Phoenix (3/4 des espèces), certains Raphia tels farinifera et excelsa, certains Chamaedorea (parfois stolonifères), certains Calamus (thysanolepis), Dypsis, Butia (ou monocaule), Caryota mitis, Nannorrhops, Trithrinax…



– Acaule
Les palmiers au stipe souterrain ou semi-souterrain peuvent ne faire apparaître que leurs feuilles, mais certains genres développent quand même un stipe aérien assez court, c’est, par exemple, le cas du palmier nain, Phoenix acaulis.
Quelques exemples : Allagoptera campestris, Syagrus campylospatha, Dypsis lutescens et acaulis, certains Sabal… et surtout le remarquable palmier d’Indonésie et de Thaïlande, Johannesteijsmannia altifrons.
Certains palmiers souterrains commencent à développer leur petit stipe en poussant vers le bas en profondeur, puis continuent de croître en se redressant, on parle de croissance ‘saxophone’ ; leur petit stipe peut devenir aérien mais, souvent, seules leurs feuilles se déploient à l’air libre, c’est le cas des Sabal nain, du Brahea moorei, du Pinanga subterranea…
– Liane
De nombreux palmiers sont grimpants, et d’après certains cela concernerait un quart d’entre eux ; leurs feuilles pennées ou entières se trouvent séparées par des tronçons de stipe grêles.
Les plus connus sont les rotins, souvent du genre asiatique Calamus (du grec signifiant roseau), le nom populaire rotin vient du malais rotan pour désigner un palmier grimpant. Ils vivent généralement dans les forêts humides tropicales où ils arrivent à développer des tiges d’un diamètre de 10 cm maximum et de 170 m, jusqu’à plus de 200 m de long pour l’espèce manan dont un stipe a été mesuré à 240 m dans le jardin botanique de Bogor en Indonésie !
Les palmiers grimpants sont en majorité originaires de l’Ancien-Monde, mais on trouve deux palmiers grimpants dans le Nouveau-Monde : genres Chamaedorea et Desmoncus.
Certains palmiers tels Calamus et Desmoncus, afin de grimper, transforment la foliole terminale des feuilles en un cirre (ou cirrhe), une sorte de vrille épineuse ressemblant à un fouet, d’autres développent des épines sur leur stipe, et certains se contentent de ramper tels le palmier nain de Floride Serenoa repens ou le Chamaedorea eliator qui rampe ou grimpe selon les conditions offertes grâce à ses feuilles particulièrement rigides et réfléchies à l’extrémité, ce serait un des rares palmiers grimpants non épineux (voire le seul ?).
Apparences
L’apparence du stipe dépend de la disposition des feuilles, et surtout des caractéristiques de la base du pétiole dont il est constitué.
La feuille issue du bourgeon terminal est portée par un pétiole dont la base engainante (la gaine) est issue d’une modification de sa base afin de renforcer l’attache au stipe ; certains appellent cette gaine un pseudo-pétiole ; le Nypa des mangroves est une des rares espèces à ne pas développer de gaine.
Parfois, chez certaines espèces, il se développe un manchon foliaire issu de l’emboitement des gaines tubulaires pouvant être impressionnant, les gaines s’enroulent alors l’une sur l’autre, c’est le cas des Archontophoenix, des Roystonea (jusqu’à 2 m)… Ce manchon foliaire apparaît chez les espèces de grande taille ; sous l’effet de forte tempêtes, le pétiole se casse au sommet du manchon, ainsi le bourgeon apical reste protégé.

Non seulement cette gaine assure un bon ancrage de la feuille mais elle joue aussi un rôle de protection du bourgeon terminal.
Selon le genre, la gaine peut parfois porter une ou des ligules (languettes) à son sommet ou sur les côtés du pétiole, les espèces à feuilles pennées n’en ont pas.
La gaine peut être fendue ou tubulaire. Elle peut être particulièrement solide et lourde, c’est le cas de la gaine du Jubaea chilensis.

À la chute des feuilles, les gaines peuvent être caduques ou persistantes, elles sont déterminantes pour l’esthétique du palmier.
Chez certaines espèces (Washingtonia, Sabal…) la base de la gaine, longtemps persistante, finit par se fendre en deux avant de se désagréger, cela donne un motif croisé très caractéristique tout au long du stipe, particulièrement chez Sabal.

Au fur et à mesure de la croissance du stipe, les feuilles les plus anciennes sont écartées du centre par les nouvelles feuilles, elles finissent par se dessécher et tomber ou, selon l’espèce, persister de différentes manières ; en botanique, la persistance d’un organe se nomme marcescence.
– Lorsque la feuille est morte, si elle est de nature à persister, elle retombe en couvrant le stipe, on parle alors de ‘jupe’.
Par esthétisme, certains préfèrent enlever les feuilles sèches rendant le stipe visible, prétextant (à tort ou à raison ?) que cela empêche la vermine de s’installer, mais cela ne parait pas vraiment utile, et même, au contraire, puisque l’ensemble des feuilles séchées protège le stipe du chaud, du froid, et des maladies, alors pourquoi contrarier la décision végétale ? Néanmoins, il est utile de considérer l’aspect général du jardin souhaité, en effet il ne serait pas adéquat de conserver les feuilles séchées d’un palmier planté au milieu d’une pelouse finement tondue et entouré de plantes soigneusement taillées ; d’autre part, de nombreux petits animaux et insectes aiment s’installer au sein des feuilles sèches, et cette présence est incompatible dans des lieux de fréquentation intense.


Les tailles utilisées, particulièrement pour le Phoenix canariensis, portent des noms caractérisant l’aspect : la taille ‘marguerite’ ne laisse en dessous du houppier qu’une seule couronne de gaines de feuilles souvent encore vertes, taille dangereuse en régions froides – la taille ‘ananas’ conserve plusieurs couronnes de bases foliaires mortes sous le houppier.


Autrefois, dans les palmeraies, les feuilles mortes des palmiers-dattiers étaient coupées en ne gardant que les gaines foliaires, ces dernières permettaient une escalade facile jusqu’aux régimes ; à l’heure actuelle, cette récolte est mécanisée.
– Chez certaines espèces, la feuille entière (limbe et pétiole) finit par se détacher laissant apparaître un stipe nu qui présente alors les cicatrices de la base foliaire (nœuds) et les espaces interfoliaires (entre-nœuds) ; ces cicatrices sont un critère d’identification. Exemples : Jubaea, Hyophorbe, Cocos, Howea, Chamaedorea, Roystonea…


Les entre-nœuds des palmiers de petit diamètre sont nettement espacés, et le stipe nu de certaines espèces laissent apparaître des tronçons grêles entrecoupés par les cicatrices du point d’ancrage des feuilles, les nœuds ; les tiges des Chamaedorea ressemblent fortement à celles des bambous.


Chez certaines espèces, le stipe est recouvert d’épines : Aiphanes, Acrocomia, Mauritiella, les Trithrinax nommés palmiers tridents portent de féroces épines persistantes de plusieurs centimètres.
Les épines du stipe sont parfois issues de la transformation de racines adventives ou bien de la dégradation de la gaine qui s’est sclérifiée. Chez certaines espèces, les épines disparaissent à une certaine maturité du palmier, d’ailleurs les Indiens d’Amérique du Sud se fiaient à la présence d’épines pour déterminer la maturité d’un palmier.

– Chez certaines espèces, le limbe et son pétiole finissent par se détacher au niveau du sommet de la gaine qui seule persiste parfois très, très longtemps.
En se désagrégeant, la gaine de certaines espèces forme des filaments éparses qui, après quelques années, finissent par laisser un stipe nu (Caryota, Arenga…).


Chez d’autres espèces, les gaines en se désagrégeant s’entremêlent entre elles, et forment une bourre fibreuse protectrice et persistante qui entoure le stipe et la base des gaines à venir. Chez les Trachycarpus, l’espèce fortunei est particulièrement fibreuse d’où son nom de palmier chanvre, seules les fibres de l’espèce martianus persistent peu de temps.

Mise à jour le 8 juillet 2024.